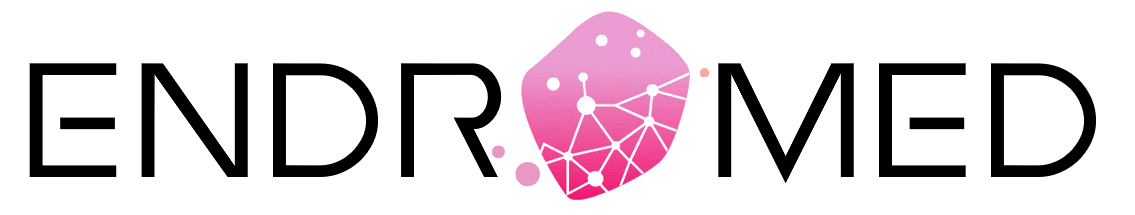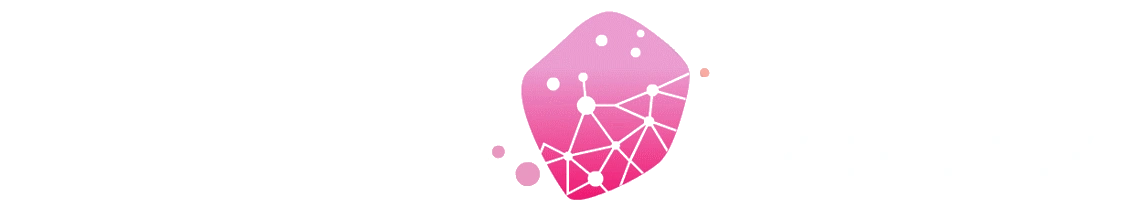Eau hydrogénée vs Vitamine C : quel est le meilleur antioxydant pour la peau ?
29 août 2025
endromed.fr
Introduction
L’oxydation par les radicaux libres est l’un des mécanismes majeurs du vieillissement cutané et de nombreuses affections de la peau. Deux approches antioxydantes suscitent aujourd’hui un vif intérêt en dermatologie : la vitamine C (acide ascorbique), un antioxydant classique bien connu, et l’hydrogène moléculaire (H2) administré via de l’eau hydrogénée. L’eau hydrogénée est de l’eau enrichie en hydrogène moléculaire dissous, dont la capacité à neutraliser les radicaux libres a été récemment mise en avant pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Par exemple, la technologie Inpure® illustre une application clinique de l’hydrogène : cet appareil de soin visage génère de l’eau hydrogénée sur place pour profiter des effets antioxydants puissants de H2 lors d’un hydropeeling. L’objectif de cet article est de comparer, de façon non promotionnelle, les effets de l’eau hydrogénée et de la vitamine C sur la peau – en particulier sur le vieillissement cutané, l’inflammation, les taches pigmentaires et l’éclat du teint – en examinant leurs mécanismes d’action, leurs données cliniques et leurs profils de biodisponibilité et de tolérance, à l’appui des publications scientifiques disponibles (PubMed).
Mécanismes d’action antioxydante
Vitamine C (acide ascorbique) : La vitamine C est un puissant antioxydant hydrosoluble naturellement présent dans la peau. Son mode d’action principal consiste en un don d’électrons séquentiel aux espèces réactives de l’oxygène (ROS) afin de les neutraliser pmc.ncbi.nlm.nih.gov. En d’autres termes, l’acide ascorbique réduit les radicaux libres (superoxyde O2−•, peroxyde, radical hydroxyle •OH, etc.) en formant des formes oxydées stables (acide déshydroascorbique), qui peuvent ensuite être régénérées en vitamine C active par des enzymes cellulaires pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Cet effet antioxydant direct protège les cellules cutanées du stress oxydatif induit par les UV, la pollution ou le tabac : in vitro, la vitamine C réduit ainsi les dommages à l’ADN et aux membranes lipidiques après irradiation UV, limite la libération de cytokines pro-inflammatoires (ex. IL-6, IL-8) et prévient l’apoptose des kératinocytes lpi.oregonstate.edu. Par ailleurs, la vitamine C participe au système antioxydant enzymatique de la peau en synergie avec d’autres antioxydants endogènes (glutathion, vitamine E…), qu’elle aide à régénérer. Enfin, indépendamment de son action antiradicalaire, l’acide ascorbique intervient comme cofacteur essentiel de la synthèse du collagène, en réduisant le fer et le cuivre au sein des enzymes prolyl- et lysyl-hydroxylases pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Cette hydroxylation des fibres de collagène est indispensable à la maturation et à la stabilisation du collagène dermique pmc.ncbi.nlm.nih.gov. La vitamine C stimule également directement la production de collagène en activant la transcription des gènes procollagènes et en stabilisant l’ARN messager du collagène dans les fibroblastes pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Simultanément, elle diminue l’expression des métalloprotéinases (MMP) induites par les UV qui dégradent le collagène, et réduit la surproduction d’élastine anormale observée dans le photovieillissement lpi.oregonstate.edulpi.oregonstate.edu. L’ensemble de ces actions fait de la vitamine C une molécule antioxydante et pro-cicatrisante de premier plan pour la peau lpi.oregonstate.edulpi.oregonstate.edu.
Hydrogène moléculaire (H2) : Le dihydrogène est un gaz incolore dont l’utilisation médicale émergente repose sur ses propriétés antioxydantes sélectives. La molécule H2 est capable de diffuser très rapidement à travers les membranes cellulaires du fait de sa petite taille et de l’absence de polarité pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Ainsi, l’hydrogène inhalé ou dissous peut pénétrer dans le cytosol, le noyau et même les mitochondries en quelques minutes, atteignant des compartiments où la plupart des antioxydants classiques ne peuvent accéder pmc.ncbi.nlm.nih.govjournals.lww.com. H2 est un antioxydant dit mécaniste : il réagit directement avec les radicaux les plus toxiques, en particulier le radical hydroxyle •OH et le peroxynitrite ONOO−, pour les réduire en eau ou en formes inoffensives pmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov. Cette action « piégeuse » très ciblée se fait sans interférer avec les espèces radicalaires moins réactives comme l’ion superoxyde ou le monoxyde d’azote, qui jouent aussi un rôle dans la signalisation cellulaire normale journals.lww.comjournals.lww.com. De ce fait, l’hydrogène n’entrave pas (voire stimule) certaines voies métaboliques bénéfiques régulées par les ROS modérés. Par exemple, une étude comparant H2 à la vitamine C chez le rat a montré que la vitamine C à dose élevée supprimait des signaux de biogenèse mitochondriale (facteur PGC-1α et complexes respiratoires) après un stress oxydant, alors que l’hydrogène n’avait pas cet effet délétère – H2 a même favorisé l’activation de PGC-1α et le maintien de la fonction mitochondriale post-exercice frontiersin.orgfrontiersin.org. Outre son action directe sur les radicaux libres, H2 exerce des effets modulateurs sur la signalisation cellulaire redox : il induit l’expression des voies antioxydantes endogènes via le facteur de transcription Nrf2 pmc.ncbi.nlm.nih.gov, ce qui augmente la production d’enzymes détoxifiantes (superoxyde dismutase, catalase, glutathion peroxydase) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. En parallèle, l’hydrogène a des propriétés anti-inflammatoires documentées, dues en partie à l’inhibition de la cascade du NF-κB, un régulateur clé de l’inflammation pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Il réduit l’infiltration des neutrophiles et macrophages dans les tissus lésés et diminue la libération de cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, IL-6, TNF-α, etc.) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. De plus, H2 stabilise les mastocytes (cellules de l’allergie) en empêchant leur dégranulation, ce qui réduit la libération d’histamine et atténue les réactions inflammatoires et prurigineuses pmc.ncbi.nlm.nih.gov. L’ensemble de ces mécanismes – neutralisation sélective des radicaux les plus nocifs, activation des défenses antioxydantes et régulation négative de l’inflammation – confère à l’hydrogène une position particulière parmi les antioxydants. Contrairement à la plupart des antioxydants classiques (vitamines C, E, polyphénols) à “fort pouvoir réducteur”, l’hydrogène n’a aucune cytotoxicité connue même à haute dose et n’affecte pas les paramètres physiologiques normaux (température, pression sanguine, pH…) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. On notera simplement que H2 est un gaz inflammable au-dessus de 4% de concentration dans l’air, mais les modalités d’administration thérapeutique utilisent des concentrations sûres bien en deçà de ce seuil (souvent 2–3% en inhalation, ou dissous dans l’eau) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. En résumé, H2 peut être considéré comme un antioxydant “moteur”, à la fois direct (il éteint immédiatement les radicaux hydroxyle) et indirect (il déclenche des réactions cytoprotectrices via Nrf2 et d’autres voies) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Ces propriétés uniques laissent penser que l’hydrogène moléculaire pourrait apporter une protection sans perturber l’équilibre redox cellulaire, là où certaines doses élevées de vitamines antioxydantes pourraient au contraire perturber des signaux biologiques utiles frontiersin.org.
Effets comparés sur le vieillissement cutané
Le vieillissement cutané résulte en partie du stress oxydatif chronique (radicaux libres induits par les UV, la pollution, le métabolisme cellulaire), qui endommage les composantes du derme (collagène, élastine, acide hyaluronique) et de l’épiderme. Les signes cliniques incluent rides, perte de fermeté, teint terne, et parfois taches de vieillesse. Vitamine C et hydrogène agissent différemment mais de façon complémentaire contre ces phénomènes.
● Vitamine C et vieillissement cutané : En tant que cofacteur indispensable à la formation d’un collagène stable, la vitamine C joue un rôle structural clé pour maintenir la fermeté et l’élasticité de la peau pmc.ncbi.nlm.nih.gov Plusieurs études cliniques ont démontré l’effet anti-âge d’une application prolongée de vitamine C topique. Par exemple, un essai clinique en double-aveugle, demi-visage, a montré qu’une crème contenant 10% d’acide ascorbique (plus 7% d’ascorbate liposoluble) appliquée pendant 12 semaines améliore significativement les rides et le score global de photovieillissement comparé au placebo pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Des biopsies de peau ont confirmé une augmentation de l’épaisseur des faisceaux de collagène dermique et une néo-synthèse de collagène de type I dans le derme sous traitement vitamine C pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Aucun signe d’irritation ou d’inflammation n’a été noté dans cet essai pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. D’autres travaux corroborent ces résultats : une revue systématique récente ayant analysé 7 études cliniques conclut que l’application de vitamine C entraîne une peau « plus lisse et moins ridée », corroborée par des analyses histologiques (augmentation des fibres de collagène) pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Il s’agit toutefois souvent d’études utilisant la vitamine C en association avec d’autres actifs cosméceutiques, ce qui rend la part exacte de l’acide ascorbique parfois difficile à isoler pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Néanmoins, la convergence des données indique que la vitamine C topique, surtout en combinaison avec la vitamine E, contribue à atténuer les rides fines, à améliorer la texture de la peau et à réparer en partie les dommages actiniques lpi.oregonstate.edulpi.oregonstate.edu. Ses effets photoprotecteurs – bien que non filtrants UV – ralentissent le vieillissement induit par le soleil : la vitamine C réduit l’érythème et la formation de cellules brûlées par le soleil, protège les kératinocytes du stress UV et augmente même le seuil de dose érythémateuse minimale (MED) lorsqu’elle est associée à la vitamine E lpi.oregonstate.edu. Grâce à son action à la fois préventive (anti-oxydante, anti-UV) et réparatrice (collagène), la vitamine C est aujourd’hui un ingrédient phare des soins anti-âge.
● Hydrogène et vieillissement cutané : Bien que l’utilisation de H2 en dermatologie soit relativement récente, des données préliminaires suggèrent que l’hydrogène peut lui aussi ralentir le vieillissement de la peau. Son principal atout réside dans la prévention des dommages oxydatifs in situ au niveau des cellules cutanées. Des expérimentations in vitro ont montré que traiter des fibroblastes dermiques avec de l’eau riche en hydrogène atténue les effets délétères d’une exposition aux UV : l’hydrogène prévient la diminution de viabilité cellulaire induite par les UVB, maintient l’activité des enzymes antioxydantes SOD et catalase, et réduit la peroxydation lipidique (marquée par la baisse de malondialdéhyde) dans ces cellules pmc.ncbi.nlm.nih.gov. De plus, l’hydrogène protège les kératinocytes des dégâts causés par les UVA en diminuant l’oxydation dans ces cellules et en prévenant leur apoptose pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Chez l’animal, un bain d’eau hydrogénée tiède a pu réduire la formation de rides induites par des UVA chroniques et stimuler la production de collagène de type I dans le derme de souris pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Sur le plan clinique, quelques petites études pilotes suggèrent un effet anti-âge chez l’humain. Dans une étude japonaise, six volontaires en bonne santé ont consommé chaque jour pendant 3 mois de l’eau tiède enrichie en hydrogène (0,2–0,4 mg/L H2, à 41 °C) ; on a observé à l’issue une réduction significative des rides du cou et du dos chez ces sujets pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Les auteurs ont attribué cette amélioration à l’élimination des ROS par l’hydrogène, conduisant à moins de dommages UV et à une meilleure synthèse de collagène dermique pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Une autre étude (ouverte) a évalué l’effet de bains quotidiens et de compresses d’eau hydrogénée sur le visage de 5 femmes âgées de 49 à 66 ans, pendant une période de 11 à 98 jours mdpi.com. Les résultats ont montré une diminution notable de la profondeur des rides (score moyen passant de 3,14 à 1,52 sur l’échelle d’évaluation, p < 0,001) ainsi qu’une atténuation des taches brunes ou zones d’hyperpigmentation (score passant de 3,48 à 1,74, p < 0,001) mdpi.com. De plus, l’eau hydrogénée a eu un effet favorable sur la fonction barrière : les peaux sèches ont gagné en sébum (effet hydratant) tandis que les peaux trop grasses ont vu leur sécrétion lipidique se normaliser, suggérant une modulation du micro environnement cutané mdpi.com. Bien que ces études sur l’hydrogène demeurent de petite envergure, elles indiquent un potentiel anti-âge réel : en réduisant le stress oxydatif et l’inflammation dans la peau, H2 peut freiner les processus menant aux rides et au relâchement. L’hydrogène préserve en quelque sorte l’activité physiologique des fibroblastes (synthèse de collagène, division cellulaire) que le vieillissement oxydatif tend à diminuer pmc.ncbi.nlm.nih.gov. En pratique, l’eau hydrogénée pourrait ainsi constituer un complément intéressant aux soins anti-âge classiques. À ce stade, la vitamine C reste toutefois l’actif le plus documenté pour stimuler le collagène et réparer la peau photo‐vieillie ; l’hydrogène, lui, apporte une approche nouvelle en ciblant spécifiquement les radicaux les plus agressifs et en protégeant les mitochondries des cellules cutanées du stress chronique. Il n’est pas exclu que l’association des deux – vitamine C et H2 – offre une protection synergique contre le vieillissement cutané, en attaquant le problème sur plusieurs fronts (apport de cofacteurs structuraux d’un côté, élimination ultra-rapide des ROS de l’autre).
Effets sur l’inflammation cutanée
L’inflammation cutanée est un processus clé dans de nombreuses pathologies
dermatologiques (eczéma, psoriasis, rosacée, acné…), ainsi que dans le vieillissement accéléré de la peau (inflammaging). Elle est souvent alimentée par le stress oxydatif : les ROS activent des voies pro-inflammatoires (telles que NF-κB et AP-1) qui induisent la production de cytokines et de métalloprotéases délétères pour la peau pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Vitamine C et hydrogène possèdent tous deux des effets anti-inflammatoires, quoique par des mécanismes un peu différents.
● Vitamine C et inflammation : En neutralisant les radicaux libres, la vitamine C réduit
indirectement les stimuli oxydatifs qui déclenchent l’inflammation. Par exemple, il a été observé que l’ajout de vitamine C en culture de kératinocytes cutanés inhibe la libération de cytokines pro-inflammatoires après un stress UV (diminution d’IL-1, IL-6) lpi.oregonstate.edu. De plus, la vitamine C protégerait les cellules immunitaires de la peau (par exemple les cellules de Langerhans) du stress oxydatif, préservant ainsi leur fonction et modulant la réponse inflammatoire aux agresseurs externes lpi.oregonstate.edu. Sur le plan clinique, la vitamine C topique est utilisée en soutien dans certaines conditions inflammatoires : des formulations de sodium ascorbyl phosphate (un dérivé stable de Vit C) ont montré une réduction des lésions inflammatoires de l’acné légère à modérée, possiblement grâce à l’effet antibactérien et anti-inflammatoire de ce dérivé lpi.oregonstate.edu. Dans le psoriasis ou la dermatite atopique, la vitamine C orale à haute dose a parfois été proposée pour ses vertus antioxydantes systémiques, avec des résultats mitigés. Néanmoins, il est admis que des carences en vitamine C aggravent l’inflammation cutanée (comme on le voit dans le scorbut, où les plaies s’enflamment et cicatrisent mal), tandis qu’un statut correct en vitamine C favorise une meilleure résolution des phénomènes inflammatoires dans la peau lpi.oregonstate.edu. Ainsi, sans être un anti-inflammatoire au sens pharmacologique, la vitamine C crée un environnement cutané moins propice aux réactions inflammatoires excessives.
● Hydrogène et inflammation : L’hydrogène moléculaire possède des effets
anti-inflammatoires démontrés, issus de son double rôle antioxydant et modulateur
immunitaire. Des études sur modèles animaux de dermatite ont montré que
l’administration d’hydrogène (par eau hydrogénée ou injection saline H2) réduit
significativement les taux de cytokines comme TNF-α, IL-6, IL-17 dans les tissus et
freine l’infiltration des cellules inflammatoires pmc.ncbi.nlm.nih.gov. H2 agit notamment en inhibant la voie NF-κB dans les cellules cutanées endommagées, ce qui empêche
l’escalade de la réaction inflammatoire pmc.ncbi.nlm.nih.gov. De plus, en stabilisant les mastocytes, l’hydrogène diminue les symptômes de l’inflammation aiguë (oedème, démangeaisons, rougeurs) dans des modèles d’allergie cutanée pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Chez l’humain, les premières applications de l’hydrogène dans des maladies de peau à composante inflammatoire sont encourageantes. Une étude clinique publiée en 2018 a évalué des bains d’eau hydrogénée chez 41 patients atteints de psoriasis (maladie inflammatoire chronique de la peau) et 6 patients atteints de parapsoriasis en plaques. Après 8 semaines de bains (2 fois par semaine), 56% des patients psoriasiques traités à l’eau hydrogénée ont obtenu une amélioration d’au moins 50% de leur score PASI (indice de sévérité du psoriasis), contre seulement 18% dans le groupe témoin pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Des améliorations significatives du prurit et de la qualité de vie ont également été notées dans le
groupe H2 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Chez les patients atteints de parapsoriasis (une affection apparentée), 4 sur 6 ont présenté une réponse clinique partielle et 2 une rémission complète dès 4 semaines de balnéothérapie hydrogénée pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Aucun effet indésirable n’est rapporté, et certains patients ont pu réduire leur posologie de traitements systémiques agressifs grâce à l’appoint de ces bains pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Ces résultats suggèrent que l’hydrogène, en neutralisant localement l’excès de radicaux libres, atténue l’inflammation cutanée chronique et favorise la guérison ou l’amélioration de dermatoses inflammatoires résistantes pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. D’autres travaux ont rapporté des bénéfices de l’eau H2 dans la dermatite atopique : par exemple, des bains hydrogénés ont réduit les lésions d’eczéma et le prurit chez des patients atopiques dans une petite série, en lien avec une baisse des marqueurs de stress oxydatif et d’inflammation dans la peau. On constate aussi un effet cicatrisant de l’hydrogène sur les plaies : chez des patients alités avec escarres, l’administration d’eau hydrogénée par sonde gastrique a accéléré la guérison des ulcères de pression, possiblement via une stimulation de la production de collagène et une
augmentation de l’activité mitochondriale dans les kératinocytes du lit de la
plaie pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Globalement, l’hydrogène semble agir comme un régulateur immunitaire doux : il ne bloque pas complètement l’inflammation (qui est utile pour combattre les infections ou initier la réparation), mais il empêche les excès délétères en réduisant l’orage oxydatif et en modulant les médiateurs clés. Ceci pourrait s’avérer particulièrement utile pour les maladies de peau où l’inflammation chronique joue un rôle central (psoriasis, eczéma,
rosacée…), en complément des traitements existants, avec l’avantage d’un profil de
sécurité excellent.
Effets sur les taches pigmentaires et l’éclat de la peau
Un teint terne, des taches brunes (lentigos solaires, mélasma) et une perte d’éclat sont souvent liés à un stress oxydatif et inflammatoire de la peau. Les ROS et l’inflammation stimulent la production de mélanine de manière anarchique (hyperpigmentation
post-inflammatoire, mélanogénèse UV-induite) et oxydent les pigments existants en leur donnant une teinte plus foncée. Sur ce plan, vitamine C et hydrogène offrent aussi des bénéfices, quoique la vitamine C soit plus directement ciblée sur la mélanine.
● Vitamine C et pigmentation : L’acide ascorbique est reconnu pour ses propriétés éclaircissantes sur le teint. Il agit à plusieurs niveaux de la mélanogénèse : d’abord comme un inhibiteur indirect de la tyrosinase (enzyme clé qui permet la synthèse de mélanine) – la vitamine C réduit le cuivre présent dans le site actif de la tyrosinase, ce qui freine son activité enzymatique. Elle peut ainsi diminuer la production de mélanine nouvelle dans les mélanocytes surstimulés lpi.oregonstate.edu. Ensuite, grâce à son pouvoir réducteur, l’acide ascorbique peut décolorer la mélanine oxydée déjà formée : il transforme la forme oxydée brun-noir de la mélanine (indoleum-mélanine) en une forme plus claire (léucodopachrome), ce qui explique en partie son effet sur les taches existantes lpi.oregonstate.edu. Concrètement, des applications prolongées de vitamine C topique ont montré une amélioration de troubles pigmentaires comme le mélasma ou les lentigos. Une revue de 2023 sur l’usage de la vitamine C dans le mélasma a conclu qu’elle apporte une atténuation significative des hyperpigmentations avec un bon profil de tolérance, même si des mois de traitement sont souvent nécessaires et que la stabilité de la formulation est un défi pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. La vitamine C est parfois utilisée en combinaison avec des lasers (par ex. laser Nd:YAG) pour
potentialiser son entrée dans la peau et son effet dépigmentant pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. En pratique, des sérums à 15–20% d’acide ascorbique appliqués quotidiennement peuvent, après 2–3 mois, éclaircir des taches brunes modérées et uniformiser le teint, en particulier lorsqu’il s’agit de pigmentation post-inflammatoire ou liée au photovieillissement. Son effet « coup d’éclat » est également prisé en cosmétique : en neutralisant les radicaux libres, la vitamine C réduit la carnation terne due à l’oxydation des protéines de surface, et son effet exfoliant léger (à pH acide) peut lisser la couche cornée donnant ainsi plus d’éclat. À noter que la vitamine C n’est pas dépigmentante au sens fort (comme l’hydroquinone) et n’entraîne pas de risques d’hypopigmentation excessive ; son action est modulatrice, ce qui convient aux soins éclaircissants d’entretien ou en post-traitement d’un mélasma, par exemple.
● Hydrogène et pigmentation/éclat : L’hydrogène moléculaire n’agit pas directement sur la synthèse de la mélanine comme peut le faire la vitamine C, mais son rôle
anti-oxydant et anti-inflammatoire a des conséquences positives sur les désordres pigmentaires. En réduisant le stress oxydatif global de la peau, H2 limite la cascade d’événements qui mène à l’hyperpigmentation. Par exemple, après une exposition
aux UV, de nombreuses ROS sont produites et stimulent les mélanocytes à fabriquer plus de pigment (mécanisme de bronzage ou de tache solaire). En neutralisant rapidement ces ROS nocives, l’hydrogène pourrait atténuer la suractivation des mélanocytes et ainsi prévenir ou réduire l’intensité des taches brunes post-UV. De même, dans l’hyperpigmentation post-inflammatoire (tache résiduelle d’acné ou d’eczéma), l’inflammation locale entretient une production de mélanine excessive et une oxydation des pigments. Là encore, l’action calmante de H2 sur l’inflammation pourrait accélérer le retour à une pigmentation normale. Les observations cliniques de l’étude de Tanaka et al. 2022 appuient cette idée : après 1 à 3 mois de bains et compresses d’eau hydrogénée, ces auteurs ont noté une diminution des “blotches” (mot traduit par « taches » ou mouchetures pigmentaires) parallèle à la diminution des rides chez leurs participantes mdpi.com. Bien que l’évaluation soit restée globale, l’amélioration de plus de 50% du score des taches pigmentaires suggère un éclaircissement du teint sous l’effet de l’hydrogène. De plus, l’hydrogène a montré dans cette étude un effet régulateur de l’hydratation et du sébum cutanés, ce qui contribue à l’éclat : une peau bien hydratée et équilibrée en lipides reflète mieux la lumière et paraît plus lumineuse mdpi.com. Enfin, en
protégeant le collagène et en réduisant les lésions oxydatives, l’hydrogène aide à maintenir une texture cutanée lisse et homogène, facteur important pour l’éclat du teint. Il convient de rester prudent : H2 n’est pas un agent dépigmentant au sens strict, et il n’a pas l’historique de la vitamine C dans le traitement des mélasmas ou lentigos. Mais en prévention du teint terne et des taches liées au stress oxydatif quotidien, l’hydrogène pourrait jouer un rôle. Par exemple, une consommation régulière d’eau hydrogénée ou l’utilisation de brumisateurs d’eau hydrogénée pourrait, sur le long terme, aider à conserver une peau plus claire et éclatante en minimisant les micro-dommages oxydatifs quotidiens qui s’accumulent et ternissent le teint. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour quantifier l’effet de H2 sur la mélanine (des dosages de mélanine, des biopsies avec comptage de mélanocytes après traitement H2 seraient utiles). Néanmoins, les premiers indices laissent penser que l’hydrogène apporte au moins un effet « bonne mine » indirect, en réduisant l’inflammation sub-clinique et le stress oxydatif responsables d’un teint fatigué.
Biodisponibilité cutanée, stabilité et modalités d’utilisation
L’efficacité d’un actif antioxydant dépend non seulement de son pouvoir intrinsèque, mais
aussi de sa capacité à atteindre les couches de la peau en quantité suffisante, dans une
forme stable.
Vitamine C – absorption et stabilité : L’acide ascorbique pur est une molécule hydrophile
de petite taille, cependant la peau humaine oppose une barrière importante à sa pénétration
: la couche cornée de l’épiderme limite la diffusion des substances hydrosolubles. Des études ont montré que l’absorption percutanée de la vitamine C est très dépendante des conditions de formulation, notamment du pH et de la concentration : un pH suffisamment acide (< 4,0) est nécessaire pour que l’acide ascorbique reste sous sa forme non ionisée, favorable à sa diffusion à travers la cornée lpi.oregonstate.edu. De plus, l’efficacité d’absorption plafonne à une concentration d’environ 20% : des solutions à 20% d’ascorbique ont une pénétration optimale, tandis qu’à 30% l’absorption cutanée mesurée diminue (probablement par saturation ou instabilité) lpi.oregonstate.edu. En pratique, les sérums ou crèmes contiennent généralement entre 10% et 20% de vitamine C, avec un pH autour de 3 ; au-dessus, la pénétration devient aléatoire. Un défi majeur avec la vitamine C est sa stabilité chimique. L’acide L-ascorbique à l’état libre est très sensible à l’oxydation : en solution aqueuse, il se dégrade au contact de l’air, de la chaleur ou de la lumière, se transformant en acide déshydroascorbique puis en acide diketogulonique (inefficaces et potentiellement irritants). Ainsi, un sérum de vitamine C mal formulé peut perdre une grande partie de son activité antioxydante en quelques semaines après ouverture. Pour contourner ce problème, l’industrie a développé des dérivés stables de la vitamine C : par exemple l’ascorbyl-2-phosphate (AAP, forme estérifiée hydrosoluble) ou l’ascorbyl tetraisopalmitate (ATIP, forme liposoluble). Ces dérivés sont plus résistants à l’oxydation mais présentent une perméabilité cutanée limitée et doivent être convertis in vivo en acide ascorbique pour être actifs lpi.oregonstate.edu. L’ascorbyl-2-phosphate pénètre modérément dans la peau et sa conversion peut être incomplète, réduisant son efficacité antioxydante réelle lpi.oregonstate.edu. L’ascorbyl palmitate (forme lipophile) traverse mieux la couche cornée, mais des études in vitro ont suggéré qu’à forte dose il pourrait avoir un effet pro-oxydant cytotoxique dans les kératinocytes lpi.oregonstate.edu. Malgré ces limites, de nombreux produits utilisent ces dérivés pour apporter une stabilité acceptable. Des formulations combinant plusieurs antioxydants peuvent par ailleurs se protéger mutuellement de l’oxydation : l’ajout de vitamine E ou d’acide férulique dans un sérum à la vitamine C stabilise nettement l’ascorbique et double même son efficacité photoprotectrice selon certaines études lpi.oregonstate.edu. Sur le plan de la biodisponibilité systémique, la vitamine C ingérée par voie orale ne se concentre dans la peau que jusqu’à un certain point : la peau est fortement dépendante du transport sanguin d’ascorbate, mais une fois la vitamine C plasmatique saturée (au-delà de ~100 mg/jour en ingestion), la concentration cutanée n’augmente plus proportionnellement lpi.oregonstate.edu. Il est donc difficile d’accroître la teneur en vitamine C de la peau par la seule voie orale. L’application topique contournant la barrière gastro-intestinale, elle permet d’obtenir localement dans l’épiderme et le derme des taux d’ascorbate supérieurs à ceux obtenus par voie orale lpi.oregonstate.edu. En résumé, pour une bonne biodisponibilité cutanée de la vitamine C, il faut : une formulation à pH acide (~3,5) contenant 10–20% d’acide ascorbique, protégée de l’air et de la lumière (flacon opaque, limitation de l’ouverture à l’air), ou bien recourir à des dérivés stables en acceptant une potentielle moindre efficacité. Ces contraintes expliquent que tous les produits à la vitamine C ne se valent pas ; les médecins et patients doivent privilégier les formulations ayant fait l’objet d’études de pénétration et de stabilité.
Hydrogène – délivrance à la peau : Assurer la biodisponibilité de H2 pour la peau est un
défi d’un autre ordre. L’hydrogène est un gaz, qui se dissout dans l’eau jusqu’à une
concentration maximale d’environ 0,8 mM (soit 1,6 mg/L) à pression atmosphérique pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Cette solubilité relativement faible signifie qu’une eau hydrogénée saturée contient une quantité absolue d’H2 limitée. De plus, le H2 dissous s’échappe rapidement du liquide dès qu’il est exposé à l’air (le gaz diffuse hors de l’eau en quelques minutes si le récipient est ouvert). Ainsi, pour apporter suffisamment d’hydrogène à la peau, il faut soit renouveler l’H2 en continu, soit empêcher son évaporation. Plusieurs stratégies existent :
● Bains et compresses hydrogénés : Plonger la peau dans de l’eau enrichie en
hydrogène (bain du corps entier, bain de mains/pieds, compresses faciales imbibées)
permet une diffusion directe de H2 à travers l’épiderme pendant la durée de
l’application. Dans le protocole de Tanaka et al., le bain facial durait 10 minutes dans
une eau à 41 °C saturée en H2 (environ 0,3–0,7 mg/L) mdpi.com. Pendant ce laps de
temps, l’hydrogène diffusant peut pénétrer la couche cornée et atteindre l’épiderme
viable et le derme superficiel. L’avantage est que le contact prolongé compense en
partie la fuite du gaz (le bain maintient une réserve de H2). Les études sur animaux
suggèrent que ce mode d’administration transcutané élève le taux d’hydrogène dans
les tissus sous-jacents, avec des effets thérapeutiques mesurables (ex : diminution de l’inflammation dans un modèle d’ischémie cutanée) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Les bains sont donc une bonne option pour des affections étendues (psoriasis, eczéma généralisé) ou pour un soin périodique du visage. Leur limite pratique réside dans la nécessité de préparer de l’eau hydrogénée fraîche à chaque utilisation, idéalement à saturation : en effet, une bouteille d’eau hydrogénée du commerce pourrait avoir perdu une partie de son H2 si elle n’est pas utilisée immédiatement. Des générateurs domestiques d’eau hydrogénée existent, permettant de produire de l’eau riche en H2 à la demande (par électrolyse de l’eau) pmc.ncbi.nlm.nih.gov.
● Sprays et appareils diffusant H2 : Pour une utilisation cosmétique plus régulière, des
brumisateurs d’eau hydrogénée ou des appareils combinés (comme l’Inpure® cité
plus haut) diffusent de l’eau enrichie en hydrogène directement sur la peau du
visage. L’Inpure, par exemple, incorpore un générateur d’hydrogène par
électrolyse et applique cette eau H2 via un système de « HydraJet » sur la peau,
tout en aspirant les impuretés et en diffusant des actifs hydratants. Cette approche a
l’avantage de fournir du H2 en continu pendant le soin, assurant une exposition
cutanée suffisante malgré l’évasion rapide du gaz. Les appareils de ce type tentent
de surmonter la faible stabilité de H2 en créant in situ un flux constant d’hydrogène
vers la peau. Cela s’apparente à une perfusion topique d’antioxydant. Tant que
l’appareil fonctionne, la peau reçoit H2; dès l’arrêt, l’hydrogène résiduel dans la peau
finira par se consumer ou se dissiper en une à deux heures (demi-vie brève dans les
tissus). Notons qu’en inhalation médicale, on utilise parfois des mélanges 2-4% H2 en
oxygène pendant plusieurs heures afin de saturer le sang puis les tissus en
hydrogène. Pour la peau, une exposition locale via de l’eau ou du gaz humide
semble suffisante pour obtenir des effets, sans qu’il soit nécessaire de saturer tout le
corps.
● Voie systémique (boisson, inhalation) : Boire de l’eau hydrogénée peut apporter H2 à
la peau via la circulation sanguine. Environ 40% de l’hydrogène ingéré par de l’eau
serait retenu transitoirement dans l’organisme et distribuée aux organes pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Cependant, la quantité atteignant la peau reste incertaine et dépend de la perfusion cutanée. Une étude chez le rat n’a pas détecté d’augmentation notable d’H2 cutané après ingestion, possiblement car la méthode de détection n’était pas assez sensible pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Néanmoins, des volontaires humains buvant 1,5 L d’eau hydrogénée par jour pendant 4 semaines ont montré des signes biologiques d’atténuation du stress oxydatif systémique (diminution de composés oxydés dans le sang) pmc.ncbi.nlm.nih.gov, ce qui peut indirectement bénéficier à la peau (organe reflétant l’état général). L’inhalation d’hydrogène, quant à elle, pourrait théoriquement apporter H2 aux structures profondes de la peau via l’irrigation sanguine, mais cette voie est plutôt utilisée pour des indications systémiques (ex : pathologies pulmonaires, neurologiques). Pour un usage cosmétique courant, elle n’est pas pratique ni ciblée.
En somme, la biodisponibilité cutanée de l’hydrogène repose sur une application topique
fréquente et/ou prolongée. L’eau hydrogénée doit être utilisée rapidement après sa
production pour éviter la perte du gaz. L’innovation technologique (appareils portatifs,
masques imbibés, hydrogel à microbulles d’H2) est en développement pour améliorer la
pénétration et la rétention de H2 dans la peau pmc.ncbi.nlm.nih.gov Par exemple, des nano-bulles d’hydrogène encapsulées dans des gels ont montré une capacité à prolonger le temps de contact de H2 avec la peau, augmentant potentiellement l’absorption. De même, des micro-aiguilles imprégnées d’hydrogène ou des patchs occlusifs pourraient aider à « forcer » l’entrée de H2 dans l’épiderme à l’avenir pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Il faut par ailleurs souligner que l’hydrogène étant hautement diffusible, il atteint rapidement les compartiments profonds lorsqu’il est fourni en quantité ; l’enjeu est donc d’en fournir suffisamment malgré son échappement. La solution la plus simple reste d’exposer la peau à une source continue d’hydrogène (bain prolongé, dispositif électrolytique cutané) – ce que font justement certaines cliniques esthétiques via des soins spécialisés comme l’hydrofacial à l’hydrogène (Inpure® et équivalents).
Tolérance, innocuité et limites
Tolérance de la vitamine C : La vitamine C topique est globalement très bien tolérée par
la peau. C’est une substance naturellement présente dans l’organisme, non allergisante et
non sensibilisante dans la plupart des cas. Des études cliniques utilisant des solutions de 5
à 10% d’acide ascorbique n’ont rapporté aucun effet indésirable notable sur la peau lpi.oregonstate.edu. Aux concentrations plus élevées (15–20%), il peut survenir une légère irritation transitoire chez les personnes à peau sensible, en raison du pH acide requis : picotements, rougeur légère ou sensation de chaleur dans les premières minutes suivant l’application. Ces effets s’estompent en général à mesure que la peau s’accoutume ou peuvent être minimisés en espaçant les applications au début. Il est recommandé d’appliquer la vitamine C sur peau sèche (l’eau peut accentuer le ressenti acide) et d’éviter les formules contenant de l’alcool ou d’autres acides en concomitant pour réduire le risque d’irritation. Une vitamine C oxydée (par exemple un sérum jauni/brun) peut être irritante et pro-oxydante : il faut donc éviter d’utiliser un produit de vitamine C qui a changé de couleur, signe qu’il a perdu son activité et peut même générer des radicaux libres au lieu de les piéger. Par voie générale, la vitamine C est extrêmement sûre (l’excès est éliminé par les urines), bien que de très hautes doses orales (>2 g/j) puissent causer des inconforts digestifs ou favoriser des calculs rénaux chez des individus prédisposés – mais ces doses ne sont pas pertinentes pour l’usage dermatologique. Il n’y a pas de risque d’hyperpigmentation paradoxale ou d’effet rebond avec la vitamine C, contrairement à des agents dépigmentants plus agressifs. En somme, sur le plan de la sécurité, la vitamine C peut être considérée comme quasi-exempte de toxicité en usage cutané, ses seules limites étant son instabilité (qui peut la rendre inefficace) et une possible irritation mineure liée à son acidité.
Tolérance de l’hydrogène : L’hydrogène moléculaire possède un profil d’innocuité remarquable. En effet, H2 n’est pas une substance étrangère pour le corps humain : nous en produisons nous-mêmes (la flore intestinale génère chaque jour de petites quantités d’hydrogène qui diffusent dans notre organisme) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. De plus, le H2 inhalé à des concentrations même élevées (jusqu’à 4% du mélange gazeux) n’affecte aucun paramètre physiologique : une étude chez des volontaires exposés 72 heures à 2,4% d’hydrogène n’a montré aucune modification de la fréquence cardiaque, de la tension, du bilan sanguin, etc. pmc.ncbi.nlm.nih.gov. L’hydrogène n’interagit pas chimiquement avec les biomolécules hormis les radicaux hautement réactifs, il ne perturbe donc pas le métabolisme normal. En application cutanée, aucune réaction indésirable n’a été reportée dans les études cliniques (même pas d’irritation ou d’allergie) : l’eau hydrogénée a la même douceur que l’eau pure sur la peau. Par exemple, dans l’étude de bains pour psoriasis pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, les patients n’ont ressenti aucune gêne, et certains ont au contraire noté une amélioration du confort cutané (diminution du prurit, peau moins sèche). L’hydrogène n’est ni mutagène, ni cancérigène ; au contraire, des études suggèrent un potentiel anti-mutagène via la réduction du stress oxydatif génotoxique journals.l ww.comjournals.lww.com. La seule précaution concerne l’inhalation de H2 pur à haute concentration, qui peut être explosive au contact de l’air : c’est pourquoi toute inhalation thérapeutique de H2 se fait en mélange avec de l’oxygène ou de l’air (généralement ≤ 66% H2 dans 33% O2, ce mélange étant sûr et non explosif) pmc.ncbi.nlm.nih.gov. Mais en usage dermatologique topique, ce risque n’existe pas car on manipule soit de l’eau (pas d’explosion possible), soit des pourcentages minimes de gaz. En résumé, l’hydrogène se distingue par une sécurité exceptionnelle : pas d’effets secondaires connus, pas de limitation de dose du fait de la toxicité (le seul « trop » d’hydrogène imaginable serait de l’hydrogène pur inflammable, ce qu’on évite de toute façon). Cette tolérance idéale en fait un candidat intéressant y compris pour les peaux fragiles, sensibles ou pathologiques, qui ne supporteraient pas d’autres traitements.
Limites et inconvénients éventuels : Malgré leurs qualités, chaque approche a aussi ses limites. Pour la vitamine C, on l’a vu, la limite principale est sa formulation : un produit mal conçu (pH trop haut, ascorbique déjà oxydé, concentration trop faible) ne donnera pas de résultats, et pire, un ascorbique oxydé pourrait même augmenter le stress oxydant cutané au lieu de le diminuer. De plus, la vitamine C seule n’est pas un écran solaire : son effet protecteur reste incomplet et doit s’envisager en complément d’une photoprotection classique (crème SPF) et non en remplacement. Dans les hyperpigmentations marquées(mélasma prononcé), la vitamine C a un effet modeste comparé à des agents dépigmentants dédiés (hydroquinone, trétinoïne) ; elle est surtout utile en entretien et prévention des récidives plutôt qu’en traitement unique des taches tenaces. Enfin, certaines personnes ne tolèrent pas les formules acides de vitamine C (rougeurs persistantes), elles devront alors se tourner vers des dérivés plus doux ou d’autres antioxydants. Pour l’hydrogène, la contrainte principale est la délivrance comme on l’a détaillé : il ne suffit pas d’ajouter un peu d’hydrogène dans un produit et de l’oublier, car il s’échappe. Cela complique son utilisation large en cosmétique : il n’existe pas encore (en 2025) de crème “stable” chargée en hydrogène qu’on appliquerait le matin comme un sérum classique. L’hydrogène intervient plutôt via des dispositifs ou des protocoles dédiés (bains, appareils en cabinet). Cela peut être un frein à son adoption à grande échelle par le grand public, en attendant des innovations de formulation. Une autre limite est le peu de recul clinique : la recherche sur H2 en dermatologie n’a qu’une quinzaine d’années de vécu, et la plupart des études sont japonaises ou chinoises, avec des échantillons modestes. On manque de grands essais randomisés évaluant l’efficacité de l’hydrogène sur les rides ou les maladies de peau, même si les premiers résultats sont prometteurs. À l’inverse, la vitamine C bénéficie de plusieurs décennies d’usage en dermo-cosmétique avec un consensus sur ses bienfaits. Enfin, une limite potentielle de l’hydrogène est qu’il agit principalement sur le stress oxydatif et l’inflammation ; or le vieillissement cutané ou les maladies dermatologiques ont souvent d’autres dimensions (déséquilibres hormonaux, influences génétiques, etc.) sur lesquelles H2 n’a pas d’effet direct. Il ne faut donc pas le considérer comme une panacée, mais comme un outil supplémentaire ciblant spécifiquement l’oxydation excessive.
Conclusion
Vitamine C et eau hydrogénée représentent deux approches antioxydantes distinctes mais
potentiellement complémentaires pour la santé de la peau. La vitamine C, nutriment essentiel, a fait ses preuves en tant qu’antioxydant topique capable de protéger la peau du photovieillissement, de stimuler la synthèse de collagène et d’éclaircir en douceur les dyschromies. Son mécanisme bien cerné – don d’électrons aux radicaux libres et cofacteur enzymatique – en fait un allié de choix des soins anti-âge et anti-taches, à condition de l’utiliser sous une forme stable et bien absorbée. L’eau hydrogénée, de son côté, apporte l’hydrogène moléculaire H2, un antioxydant émergent dont la petite taille et la sélectivité d’action lui permettent d’atteindre rapidement les compartiments cellulaires profonds et de neutraliser les espèces radicalaires les plus délétères sans perturber les processus physiologiques. Les études initiales suggèrent que l’hydrogène peut atténuer les rides, l’inflammation cutanée et améliorer certaines dermatoses chroniques, avec un profil de tolérance excellent. Des dispositifs comme l’Inpure® témoignent de l’intérêt croissant pour traduire ces découvertes en pratiques cliniques, en intégrant l’hydrogène dans des protocoles de soin dermatologique non invasifs.
En termes de “meilleur antioxydant”, il n’y a pas forcément un vainqueur absolu : tout
dépend du contexte et des besoins. Pour un objectif de rajeunissement cutané global et de
stimulation du collagène, la vitamine C reste incontournable et hautement recommandée
dans la routine, enrichissant la peau en un facteur indispensable qu’elle ne peut synthétiser.
Pour lutter contre un stress oxydatif aigu ou chronique (pollution, UV, inflammation) et calmer les réactions délétères, l’hydrogène offre une approche innovante et puissante, capable d’agir vite et en profondeur. On peut donc imaginer qu’à l’avenir, la combinaison des deux stratégies maximise la protection : la vitamine C assurant le fond (maintien de la structure dermique, piégeage des radicaux dans l’espace aqueux cellulaire), et l’hydrogène intervenant comme un « coup d’éponge » ponctuel pour éliminer les bouffées oxydatives et moduler l’inflammation.
En pratique actuelle, un patient cherchant à améliorer l’éclat de sa peau, réduire ses rides et prévenir le vieillissement aura intérêt à utiliser quotidiennement un soin à la vitamine C stable le matin (sous protection solaire), tandis que des bains ou soins périodiques à l’eau hydrogénée pourront apporter un bénéfice additionnel, notamment en cas de peau stressée, irritée ou après une exposition intense aux UV. Les médecins et dermatologues commencent à disposer de ces deux outils : l’un bien établi, l’autre prometteur. L’important est de ne pas céder à un engouement aveugle : l’hydrogène doit continuer à être étudié rigoureusement pour définir les protocoles optimaux (durée d’application, concentration, fréquence) et confirmer sur de plus larges cohortes les effets constatés. De même, la vitamine C, malgré son ancienneté, fait l’objet de recherches pour améliorer encore sa stabilité et sa délivrance (nanocapsules, véhiculisation).
En conclusion, vitamine C et eau hydrogénée ne s’opposent pas, mais offrent deux réponses complémentaires au stress oxydatif cutané. La vitamine C apporte à la peau les moyens biochimiques de se régénérer et de se défendre, tandis que l’hydrogène agit comme un “pompiers des radicaux libres” et un anti-inflammatoire doux. Le « meilleur » antioxydant dépendra donc de l’indication : pour construire et réparer, la vitamine C excelle ; pour éteindre rapidement un excès de radicaux ou calmer une inflammation, l’hydrogène sera supérieur en rapidité d’action. Intégrer intelligemment les deux – c’est-à-dire maintenir un apport régulier en vitamine C (alimentation et topique) tout en ayant recours aux propriétés de H2 en cas de besoin – pourrait bien représenter l’avenir de la stratégie anti-âge et protectrice en dermatologie. Les prochaines années et les études à venir nous en diront plus, mais il est d’ores et déjà passionnant de voir comment une molécule aussi simple que H2 vient enrichir l’arsenal aux côtés de l’incontournable vitamine C, au service d’une peau en meilleure santé, plus lumineuse et plus résistante aux agressions du temps.
Références
1. Ohsawa I, et al. Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing
cytotoxic oxygen radicals. Nat Med. 2007;13(6):688–694. DOI:
10.1038/nm1577 pmc.ncbi.nlm.nih.gov
2. Kato S, Saitoh Y, Iwai K, Miwa N. Hydrogen-rich electrolyzed warm water represses
wrinkle formation against UVA rays together with type-I collagen production and
oxidative stress diminution in fibroblasts and keratinocytes. J Photochem Photobiol
B. 2012;106:24–33. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2011.09.006 pmc.ncbi.nlm.nih.gov
3. Tanaka Y, Miwa N. Repetitive bathing and skin poultice with hydrogen-rich water
improve wrinkles and blotches together with modulation of skin oiliness and moisture.
Hydrogen. 2022;3(2):161–178. DOI: 10.3390/hydrogen3020011 mdpi.com
4. Tian R, et al. Hydrogen, a Novel Therapeutic Molecule, Regulates Oxidative Stress,
Inflammation, and Apoptosis. Front Physiol. 2021;12:672127. DOI:
10.3389/fphys.2021.672127 pmc.ncbi.nlm.nih.gov
5. Huang L. Molecular hydrogen: a therapeutic antioxidant and beyond. Med Gas Res.
2016;6(4):219–222. DOI:
10.4103/2045-9912.196904 journals.lww.comjournals.lww.com
6. Fitzpatrick RE, Rostan EF. Double-blind, half-face study comparing topical vitamin C
and vehicle for rejuvenation of photodamage. Dermatol Surg. 2002;28(3):231–236.
DOI:
10.1046/j.1524-4725.2002.01129.x pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
7. Correia G, Magina S. Efficacy of topical vitamin C in melasma and photoaging: a
systematic review. J Cosmet Dermatol. 2023;22(7):1938–1945. DOI:
10.1111/jocd.15748 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
8. Telang PS. Vitamin C in dermatology. Indian Dermatol Online J.
2013;4(2):143–146. DOI: 10.4103/2229-5178.110593 pmc.ncbi.nlm.nih.gov
9. Zhu Q, et al. Positive effects of hydrogen-water bathing in patients with psoriasis and
parapsoriasis en plaques. Sci Rep. 2018;8(1):8051. DOI: 10.1038/s41598-018-26388-3 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
10. Farris PK. Topical vitamin C: a useful agent for treating photoaging and other
dermatologic conditions. Dermatol Surg. 2005;31(7 Pt 2):814–818. DOI:
10.1111/j.1524-4725.2005.31725l pi.oregonstate.edu
Articles récents
- Révolution du diagnostic esthétique : étude comparative œil nu vs IA Focuskin®
- Post-laser, injections, peeling : quelle place pour la LED ?
- Stimulation des fibroblastes parradiofréquence endodermique : revuedes données cliniques avec la technologie ATTIVA®
- Mieux cicatriser après une épisiotomie :l’apport de la lumière 625 + 850 nm
- Eau hydrogénée vs Vitamine C : quel est le meilleur antioxydant pour la peau ?